Peut-on réparer ses erreurs ?
Numéro 189 - Mai 2025Chacun de nous est hanté par son passé, par de mauvais choix, des maladresses, des paroles blessantes qui ont eu des conséquences néfastes sur nous-mêmes et sur notre entourage. La vie n’est pas un parcours où l’on pourrait viser le sans-faute… Mais comment échapper au regret, à la culpabilité, et tenter de compenser ce mal qui est derrière nous ?
Édito
Quand j’étais enfant en cours élémentaire, nous pratiquions un exercice que j’aimais particulièrement : la « lecture silencieuse ». Il fallait…

Signes des temps
4,1 pour 1 000C’est le niveau de la mortalité infantile en France en 2024 selon le bilan démographique de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) paru en janvier. Ce chiffre classe la France parmi les derniers en…
C’est une petite prouesse qu’a réalisée l’entreprise française Farm-3D dans la commune de Bruay-sur-l’Escaut, près de Valenciennes : la start-up a…

“Notre France, c’est un ‘non’ qui résonne en notre nom”François Ruffin, le 1er avril 2025, en meeting à Montreuil (Seine-Saint-Denis)“Pour se dire non, la pensée doit d’abord se dire oui à elle-même, être sûre d’elle”Jacques Derrida, dans…
L’image en a fait sourire plus d’un. Que fait donc le roi Charles III avec une carotte aux allures de flûte entre les mains ? La scène se déroule le 3…

Le séminaire « Race et Culture » animé à Paris-1 par les philosophes Magali Bessone, Sophie Guérard de Latour et Jamila Mascat interroge, à raison d’une séance par mois, le « problème de la race » sous différents prismes :…
Il vous est sûrement déjà arrivé de rester pantois devant l’acquisition vestimentaire d’un ami. « Ne t’inquiète pas, j’ai la vision », répliquera-il peut-être aujourd’hui. Variante : « J’ai la DA », la « direction…
Les choix de la rédaction
Le verdict du procès de l’affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national au Parlement européen a été rendu au nom de l’ordre…

Nous ne retrouverons confiance dans l’avenir qu’à condition de revoir entièrement notre conception du lien qui unit les différentes générations…

C’est ce que suggère un article récent paru dans le quotidien britannique The Guardian. Reflet d’une société où la peur d’offenser est devenue…
À l’heure où les entreprises américaines, sous l’administration Trump, abandonnent leur dispositif en faveur de la diversité, l’Europe pourrait…

Rencontre
Est-il possible qu’un texte de philosophie écrit avec l’intelligence artificielle ait une influence globale ? Telle est la question que…

Jeux de stratégie
Aux États-Unis, les démocrates se réveillent. Quelle stratégie adopter pour espérer remporter les élections de mi-mandat l’an prochain ?…

Nouvelles vagues
La mémoire et les techniques des mentalistes et autres champions de quiz télévisés nous subjuguent. Mais pourquoi nous encombrons-nous encore d…

Là est la question…
LE DILEMME D’AUDREY« Je suis mère de trois enfants, j’ai un compagnon que j’aime et qui m’aime, un métier que j’apprécie et dans lequel je m’épanouis…
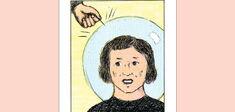
Reportage
Dans la région de Lille, médecins, infirmiers et travailleurs sociaux ont mis au point un dispositif qui n’existe nulle part ailleurs : ils…

Entretien
Il se tient à l’écart des modes intellectuelles. Mais il est capable d’enquêter plusieurs jours pour consacrer une page aux halles de Rungis ou à…

Vertiges
Pour Donald Trump, les vérités scientifiques qui dérangent sont des croyances qu’il est nécessaire de réfuter par tous les moyens. Au point de…

Dossier
Peut-on réparer ses erreurs ?
Publié leChacun de nous est hanté par son passé, les mauvais choix que nous avons pu faire, et puis les maladresses, les paroles blessantes, les actions qui ont eu des conséquences néfastes sur nous-mêmes comme sur notre entourage. La vie n’est pas un parcours où l’on pourrait viser le sans-faute, elle se nourrit de nos approximations. Et au niveau collectif, nous héritons de la mémoire des grandes erreurs historiques. Comment échapper au regret, à la culpabilité, et tenter de compenser ce mal qui est derrière nous ?Parcours de ce dossier➤ Les philosophes de la tradition hésitent : certains nous proposent de travailler sur nous-mêmes pour devenir une personne meilleure, d’autres jugeraient cette démarche trop autocentrée et nous conseilleraient plutôt de modifier notre rapport aux autres.➤ Une trahison amoureuse, un mauvais choix d’orientation professionnelle, une relation d’emprise, la dépendance aux psychotropes ou une bêtise d’étudiant qui tourne au vinaigre : nos témoins reviennent sur leurs itinéraires fracturés, qu’éclaire le philosophe qui a signé Les Vertus de l’échec, notre chroniqueur Charles Pépin.➤ Passons à la grande histoire : aujourd’hui, la question des réparations de l’esclavage est revenue sur le devant de la scène. Comment les générations présentes se positionnent-elles par rapport à la traite transatlantique et à des crimes qui remontent à plusieurs siècles ? Réponses avec l’historienne Ana Lucia Araujo, la philosophe Magali Bessone et le juriste Antoine Garapon.➤ L’un n’a cessé de s’interroger sur les erreurs du passé, en sondant l’impact des mensonges de Jean-Claude Romand dans L’Adversaire ou en fouillant sa mauvaise conscience dans Un roman russe ou Yoga. L’autre vient de consacrer une fresque mélodramatique à Emilia Pérez, un narcotrafiquant devenu une sainte après une transition de genre. Emmanuel Carrère et Jacques Audiard ont échangé sur le mythe de la deuxième chance.

Tout le monde peut se tromper, même ceux qui aspirent à bien se conduire. Une erreur, c’est un peu comme un vase qu’on aurait cassé, mais qui est…

C’est précisément parce qu’une étape nous a échappé dans l’erreur que nous sommes tentés de la réparer. Comment s’y prendre ? Sur ce point,…

Décisions regrettables, moments d’égarement… Nos cinq témoins racontent ce que leurs erreurs, professionnelles comme personnelles, leur ont appris…
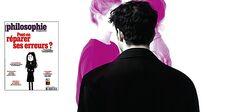
En l’occurrence, il s’agit plutôt de crimes que d’erreurs : les demandes de réparation pour les actes commis par les esclavagistes et les…

L’un est cinéaste, l’autre écrivain. Dans son film Emilia Pérez, Jacques Audiard met en scène la tentative de rédemption d’un chef de cartel qui…

Essai libre
Dans cet essai inédit, Tristan Garcia nous fait entrer dans le « chantier métaphysique » qui l’occupe actuellement, avec une grande…

Les clés d’un classique
Après avoir médusé la scène intellectuelle française des années 1930 avec ses leçons sur Hegel, le philosophe d’origine russe Alexandre…
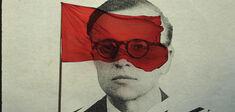
Pour prolonger notre portrait d’Alexandre Kojève, nous vous proposons une préface de Rambert Nicolas aux extraits de Sophia, à retrouver en cahier…
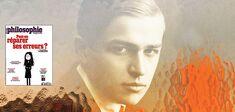
Livres
« Je suis le Ténébreux, - le Veuf, - l’Inconsolé », clamait Gérard de Nerval pour dire la perte de l’aimée, la mélancolie et la tentation…

“Enfanter une étoile qui danse”, d’Elsa Godart : mères solo, mères courage
Publié le1,5 million de femmes en France élèvent leurs enfants seules. Pour donner chair à cette enquête philosophique consacrée au quotidien de ces mères solo, Elsa Godart leur a donné la parole, interrogeant Garance, universitaire précaire, Mohana, aide-soignante dans un hôpital, ou encore Carmen, intermittente du spectacle. Le récit heure par heure de leur quotidien est à couper le souffle. Non pas parce qu’il est hors du commun mais parce qu’il expose une routine d’une banalité éreintante, faite de réveils aux aurores, d’inquiétudes et de difficultés économiques. « La monoparentalité produit de la pauvreté matérielle et de la misère humaine », affirme l’autrice, rappelant qu’une famille monoparentale sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté. Pour ces femmes prises entre deux « tunnels », celui du matin et celui du soir, la petite musique du quotidien est un métronome impitoyable. Dans cette course haletante composée de gestes mécaniques, la vie prend parfois la forme quasi exclusive de la survie. La métaphore du « trou » – celui du gouffre financier, du fossé dans lequel on sombre et qui peut mener à la dépression – revient à chaque fin de chapitre. Ce « chaos » de la parentalité n’est pas un « désordre » mais un vide métaphysique, une ouverture qui écartèle la personne, au point de la priver « de sa capacité subjective ».À force d’isoler et d’« évider » l’individu – de le vider de sa puissance –, la maternité dépossède de soi-même. Ces difficultés inhérentes à la condition parentale, et plus spécifiquement à celle des mères seules, se déroulent dans l’ombre, loin de l’arène politique. La situation ne s’est pas arrangée avec les progrès relatifs aux droits des femmes, car la maternité a longtemps été un angle mort du féminisme. Dans Le Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir s’est attelée à libérer la femme « du joug patriarcal » en dénonçant « la maternité comme assignation de la femme à une fonction biologique ». Aujourd’hui, la maternité est considérée comme un choix libre, mais la mère se retrouve face à un fossé entre « ce qui est présenté comme “possible” et ce qui est vraiment “réalisable” », à commencer par l’égalité parentale. Malgré son côté très sombre, ce constat sur la vie des mères n’est pas dénué d’optimisme. Y compris au milieu de ce chaos quotidien, celles-ci parviennent à « enfanter des étoiles dansantes ». Le titre qui reprend une formule de Friedrich Nietzsche loue l’inventivité de ces femmes qui sont en mesure, malgré tout, de « transformer le banal en œuvre » en créant des moments de joie pure avec leurs enfants, malgré la course contre la montre. Pour que ces instants soient simplement vécus et pas conquis de haute lutte, il faut, plaide Elsa Godart, faciliter la vie des mères. Aux termes de son analyse, la philosophe plaide pour un « féminisme maternel » qui viserait à revaloriser socialement les mères et à leur donner une place de véritables sujets politiques. Cela implique des chantiers législatifs, relatifs aux modes de garde des enfants et à la redistribution des richesses, mais aussi une révolution du regard, qui consisterait à reconnaître et à valoriser le travail maternel en dehors « du paternalisme étatique ou social ». On ressort de cette lecture indignée, mais pas découragée, avec l’espoir que toutes les (futures) mères parviendront enfin à voir la lumière au bout du tunnel.

Deux best-sellers issus du monde anglo-saxon attestent du succès grandissant de la Big History, ce courant qui vise à raconter l’aventure de l…
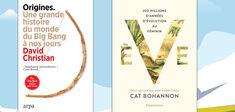
“L’imaginaire est une réalité” : le savoir gourmand de Michel Pastoureau
Publié leBleu, noir, rouge, jaune, blanc, rose… Le cochon, l’ours, le loup, le taureau, le corbeau, la baleine. Les livres de Michel Pastoureau se déclinent comme des collections, complétées avec le goût des vrais amateurs. C’est cet amour de la connaissance qu’il partage dans ce livre d’entretien conçu avec le journaliste Laurent Lemire. Si ce dialogue se concentre sur le fruit de ses recherches (l’héraldique, les couleurs, les animaux…) sans s’attarder sur les aspects biographiques ou théoriques, il reste que l’archiviste étaye une thèse solide : « Oui, pour l’historien, l’imaginaire existe. Il n’est nullement le contraire de la réalité mais en fait pleinement partie. » Le chercheur se situe ainsi dans un courant historique qui inclut des domaines a priori intangibles que sont « les croyances, les mentalités, les sensibilités, les superstitions, les peurs, les espérances et les fantasmes ». Or, pour explorer ces champs du savoir longtemps restés en friche, il fait flèche de tout bois. Ainsi, « le hasard joue un rôle important dans nos découvertes. Mais ce hasard est presque toujours lié à nos curiosités. Sans curiosités multiples, sans esprit largement ouvert, il n’y a ni recherche ni découverte. » Parmi les curiosités que nous apprennent ces échanges impromptus, il y a la parenté qu’entretient Michel Pastoureau avec Claude Lévi-Strauss, son oncle, ou son amitié avec le créateur de mode Jean-Charles de Castelbajac. Évoquant ses interventions au sein de maisons de couture comme Chanel ou Hermès, lui qu’on imagine plus spontanément à la bibliothèque qu’aux défilés de la fashion week, ajoute cette confidence amusée : « Je suis devenu un usurpateur, sinon un escroc. » En fait, cette capacité à passer aisément d’un monde à l’autre paraît indispensable au médiéviste, qui doit pouvoir se dépouiller d’une manière de penser rationaliste pour adopter celle, plus analogique, du Moyen Âge, où réalité et vérité ne se recouvrent pas. « J’ai abusé de tout et aujourd’hui je suis puni, conclut l’historien : je suis une sorte de diabétique du savoir. Un diabétique à la fois joyeux et mélancolique. »
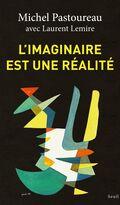
“L’Inconscient inculqué à mon ordinateur”, le “roman du mois” chroniqué par Arthur Dreyfus
Publié leComme il est rare de plonger dans un livre soulevant, en moins de 70 pages, avec une drôlerie assidue, autant de questions cruciales. Il faut avouer que l’idée de l’auteur, par ailleurs psychanalyste, est inouïe : inventer un dialogue entre deux personnages de pure fiction, une intelligence artificielle baptisée Lia, et son concepteur rêvant de la rendre plus… humaine. Par exemple, en l’initiant au rire. Peut-on cependant coder l’humour ? Avide de deep learning, Lia gobe en un éclair Gros-Câlin de Romain Gary. Est-elle pour autant capable de déterminer si le roman se termine bien ou mal ? « Pas facile. J’ai mouliné quelques minutes. J’ai relu la fin du texte, mais mon outil de contextualisation buguait. » Et dans la phrase : « C’est la voiture de ma grand-mère qui est morte », qui donc est morte ? Les deux interprètes de cette joute numérico-théâtrale en débattront. Si nous savons depuis Lacan que l’inconscient est structuré comme un langage, le verbe informatique reste fondé sur le 0 et le 1. La linguistique devient politique : comment éviter la binarisation d’un monde gouverné par les écrans ? Quand Lia commet un lapsus, telle Rachida Dati confondant « inflation » et « fellation », son concepteur crie à l’eurêka. Les codeurs de demain se mueront-ils en e-analystes ?Il y a une forme d’exploit dans ce texte : la foule de gags qu’il sème comme autant de graines réflexives n’efface aucune énigme existentielle. L’Œdipe 2.0 est né. D’Électronique ta mère aux Pères déconnectés, chaque chapitre met au jour sa propre profondeur. Ainsi que La Fontaine se servit des animaux, Diener use du miroir de la technique pour disséquer l’âme humaine. S’il fallut une loi – le droit à l’oubli – pour contraindre Google à oblitérer certaines données, c’est que les réseaux, a contrario de l’inconscient freudien, ne savent pas refouler. « M’apprendre à oublier, bégaie Lia, je veux bien essayer, mais je ne vois pas du tout l’intérêt. » Et l’on s’avise alors que les intégristes ne sont rien d’autre que des IA mal programmées : « Si l’on prend un texte au pied de la lettre, si l’on refuse la métaphore ou la distance, ça peut être très violent. Un religieux peut prendre un dessin comme une attaque physique, il peut tuer pour ça », explique-t-on à l’immature Lia, qui surchauffe : « Je n’arrive pas à < pa-parler >. » On songe à Queneau. Le fondateur de l’OuLiPo ne renierait pas ce dernier mot humain : « Quand on s’y intéresse de près, on découvre combien parler est une affaire compliquée. »
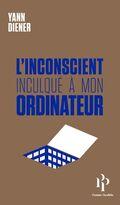
“Brouillons” : la colossale finesse de Georg Christoph Lichtenberg
Publié le« Lorsqu’il se servait de son entendement, on aurait dit un droitier obligé de se servir de sa main gauche » ou encore : « D’abord nous devons croire, ensuite nous croyons. » Longtemps, le terme d’« aphorisme » a été employé pour qualifier les écrits de Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799). Pendant deux siècles, les formules ramassées de ce scientifique, philosophe et moraliste allemand du XVIIIe siècle ont émis un rayonnement souterrain. Sous un apparent rationalisme, elles expriment souvent une dérision radicale qui met en cause les fondements de la raison. « Là où Lichtenberg rit, écrivait Goethe, c’est qu’un problème se cache. » Nietzsche le cite dans Humain, trop humain. André Breton l’avait élu pour figurer dans son Anthologie de l’humour noir. Elias Canetti voyait dans les Brouillons de Lichtenberg le livre le plus riche de la littérature universelle.En effet, l’édition intégrale de ces Brouillons donne à entendre cette voix singulière avec toute sa profondeur de champ. Non destiné à la publication du vivant de l’auteur, c’est un carnet tenu pendant des décennies. Entre récits de voyage, autoportrait et réflexions sur le vol des hirondelles, l’auteur commente les œuvres de Spinoza et de Kant. Son observation du réel coïncide avec une perception du non-sens inhérent à l’existence. Cet esprit encyclopédique du XVIIIe siècle séjourne à la frontière des sciences naturelles, de la littérature et de la philosophie. On lui doit, en physique expérimentale, la découverte de figures électriques qui portent son nom. Pourtant, sans récuser l’aventure de la connaissance, il sape comme nul autre l’excès d’optimisme des Lumières. Avec une clairvoyance qui fera l’admiration de Wittgenstein, il écrit : « Notre fausse philosophie est incorporée dans toute la langue ; nous ne pouvons pour ainsi dire pas raisonner sans raisonner faux. » À chaque page, un humour corrosif qui n’appartient qu’à lui agit comme un vaccin contre la crédulité.
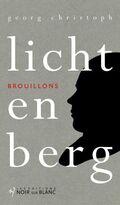
“Vivre enfin”, de François Jullien : il suffit d’oser !
Publié leC’est le plus commun des métiers, pourtant si difficile à cerner : le métier de vivre. Le verbe, précise d’emblée François Jullien, « s’entend en deux sens » : « vivre » signifie d’abord le fait élémentaire, biologique, de respirer ; mais il recouvre aussi une dimension plus existentielle et volatile, celle de se sentir « pleinement », « intensément » vivant. Expérimenter ou non la « vraie vie », penser ce qui la permet ou contraire l’obstrue, voilà ce à quoi se consacre le philosophe depuis plus d’une dizaine d’ouvrages. Ce livre reprend et développe des concepts forgés tout au long de ce parcours, par exemple les notions d’« inouï », d’« intime » ou de « seconde vie ». Compilation, simple redite ? Loin s’en faut, tant les concepts sont ici agencés et tuilés, et la tonalité d’ensemble combative. Ceci n’est pas un bilan rétrospectif ; ceci est un manifeste. Jullien déploie une éthique volontariste où l’aspiration à vivre vraiment est un défi constamment relancé. Contre l’enlisement de l’existence, son « affaissement silencieux » dans les habitudes qui dessèchent, il faut oser. Oser réapprendre à voir le monde avec un regard neuf – c’est le thème de « l’inouï », à savoir non pas ce qui est extraordinaire ou grandiose, mais ce qui n’a pas encore été entendu ou vécu réellement. Oser s’ouvrir à l’altérité et créer avec la personne aimée une sphère d’« intime » où « les remparts de notre individualité » tombent. Oser, enfin, « décoïncider » avec soi-même et se lancer dans l’aventure d’une « seconde vie » orientée par des possibles inédits. Ainsi la vraie vie n’est-elle pas « absente », comme le clamait Rimbaud. À lire Jullien, elle est bien plutôt, si l’on sait prendre son risque, une promesse tangible ici et maintenant. Ce jeu n’en vaut-il pas la chandelle ?

“Vertiges. Penser avec Borges” : Jean-Pierre Dupuy nous entraîne au bord du gouffre
Publié leDans « Les Ruines circulaires », tiré du recueil Fictions, Jorge Luis Borges imagine un personnage qui tente, nuit après nuit, de façonner un homme à travers ses rêves. Il y parvient finalement mais se rend compte qu’il est peut-être, lui aussi, le produit d’un rêve. On se demande, après avoir lu Vertiges, si Jean-Pierre Dupuy n’a été inventé, lui aussi, par l’esprit tordu de l’écrivain argentin. Au lieu de proposer une sage étude intellectuelle sur Borges, le philosophe français, qui s’intéresse autant au nucléaire qu’à l’économie ou à la religion, nous invite à prendre au sérieux son monde, à y évoluer en sa compagnie, à y approfondir ses paradoxes. Formé aux sciences, Jean-Pierre Dupuy montre que la lecture de ses contes, « fantastiques et rationnels » constitue la matrice de sa propre réflexion. Et que la logique nous amène aux bord de la folie. Peut-on empêcher ce qui doit nécessairement arriver – la catastrophe nucléaire et écologique, par exemple ? Peut-on modifier le passé ? Existe-t-il un point qui contienne tous ceux qui existent ? Peut-on trouver quelque chose de fixe dans l’infini ? Pourquoi les ingénieurs du progrès, qui veulent le bien de l’humanité, sont les êtres les plus dangereux qui soient ? Les élections sont-elles en fait une loterie ? Des questions vertigineuses naissent du calcul rationnel. De Tchernobyl à l’élection de Donald Trump, d’un film d’Hitchcock (devinez lequel) au carnaval de Rio, Dupuy entremêle les expériences marquantes de sa vie et de sa pensée avec les hypothèses et l’existence d’amoureux impuissant de Borges. Il montre surtout que la violence n’est pas l’opposée du raisonnement logique mais qu’elle est présente en lui – de la même manière que le sexe, la panique, le mal sont omniprésents dans les fables de l’écrivain. Que la vérité est dans la fiction. Et inversement

“Les Champignons de l’apocalypse” : les “mycélanées” d’Audrey Dussutour
Publié leUn champignon a contaminé la planète : les personnes touchées sont immédiatement incinérées pour protéger le reste de la population. C’est au cœur de cette ambiance apocalyptique que s’ouvre cet essai signé par la chercheuse au CNRS Audrey Dussutour, spécialiste des fourmis et des organismes unicellulaires. Partant de cette fiction, l’autrice propose une plongée dans le monde mystérieux – cette fois-ci bien réel – des champignons. Tout à leur sujet est trouble, surprenant, dérangeant… À commencer par leur règne. On a longtemps enseigné qu’ils étaient des végétaux, conformément à une classification qui remonte à Aristote lui-même. Raté ! Les découvertes génétiques récentes ont prouvé qu’ils étaient plus proches de l’animal. On peut supposer que ces êtres sont petits. Encore loupé ! Ils cachent un « vaste réseau mycélien » souterrain dont le plus grand spécimen connu, l’armillaire, situé aux États-Unis, s’étend sur plus de dix kilomètres carrés. Via cette initiation à la mycologie – la science des champignons –, Dussutour pose la question philosophique des limites. Où commence et où s’arrête un corps comme le champignon ? Comment le nommer et le distinguer des autres vivants ? Et surtout : quid de l’identité d’un être dont le seul but est de coloniser un autre individu ? Ce dernier spécimen, le champignon dit « pathogène », qui cible « autant les petites algues microscopiques que les humains », fait froid dans le dos. Un ultime chiffre ? Rien que sur le talon de votre pied, vous hébergez quatre-vingts variétés de champignons (si vous êtes sain !). Ces êtres ultra-résistants sont partout parmi nous, y compris dans nos corps : et si l’on apprenait à les connaître ?
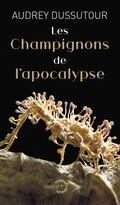
“Qu’est-ce que ça fait d’être une chauve-souris ?” : la boussole écho-logique de Thomas Nagel
Publié leLes exemples philosophiques les plus célèbres tombent parfois du ciel. « L’expérience inquiétante d’un contact intime » avec une chauve-souris égarée dans sa maison de Pennsylvanie donne à Thomas Nagel l’intuition de son célèbre article de 1974, enfin réédité. Il y montre comment une connaissance objective, fût-elle complète, d’une chauve-souris ne permettra jamais de savoir ce que cela fait d’en être une. Nous pouvons, par exemple, détailler comment, via l’écholocalisation, ces chiroptères parviennent à s’orienter en réverbérant des ultrasons sur des obstacles lors de leurs parties de chasse nocturnes. Mais cela ne nous dit rien de ce que cela fait de le vivre « à la première personne ». Le problème persiste si nous nous imaginons « avec de la toile fixée aux bras […] passant la journée dans un grenier, suspendu par un pied et la tête en bas ». Ce ne serait là qu’une pâle projection détaillant ce que cela fait de faire comme si nous étions une chauve-souris. Seulement, les difficultés d’accès à cet autre point de vue subjectif ne nous autorisent pas à déduire qu’il n’y en a pas. Nagel prend alors position contre cette « réduction du mental au physique », déjà en vogue. Il transpose son discours des chauves-souris aux humains : nous avons beau comprendre toujours mieux les gerbes électriques de nos neurones, notre conscience demeure un point aveugle. Dans une préface et une postface inédites, Nagel rappelle comment son article a aussi amplifié les débats naissants sur la conscience animale. Éminemment actuelle, sa thèse interdit tout anthropomorphisme : avant de se précipiter sur les autres espèces pour y plaquer des « similarités comportementales » avec nous, mieux vaut « savoir s’il existe quelque chose comme ce que ça fait d’être elles ». À l’image de Nagel, inquiet dans sa maison hantée par une chauve-souris, supposant qu’elle « ressentait la même chose » que lui, sans pourtant ne rien savoir d’autre que l’écho nocturne de son étrange point de vue.

Arts
Pour parler de justice, Lorraine de Sagazan convoque un monstre : le Léviathan. Le philosophe Thomas Hobbes a fait de cet animal biblique une allégorie de…

De la situation, nous ne savons rien sinon que c’est la crise. Les membres du G7 – le groupe réunissant les dirigeants allemand, canadien, américain,…

« Elle a le sort précaire de tout ce qui brille, du papillon et de la fleur, l’affiche qui rutile sous le soleil, pâlit au travers des brumes, et dont les…

Comme des grands
Questionnaire de Socrate
« Grande est ma chance », chante Jeanne Cherhal dans son nouvel album, Jeanne, qui prend des airs d’amor fati. Ce grand oui à la vie,…

