Comment se changer les idées ?
Numéro 190 - Juin 2025Comment retrouver une bouffée d’air frais alors que nos existences sont percutées par l’actualité pressante du monde et qu’il nous faut affronter des épreuves dans nos vies personnelles ? Peut-on se divertir sans se leurrer ? C’est précisément la promesse de la philosophie que de nous transformer en changeant nos idées sur le monde. Nous explorons ainsi dans ce numéro les voies pour échapper à la saturation !
Édito
Les idées, ça ne marche pas comme les chatouilles. C’est même l’inverse.Je ne sais pas si vous avez essayé, je me doute bien que oui, mais une chose est…

Signes des temps
63 %C’est la proportion dans laquelle les insectes ont disparu entre 2021 et 2024 au Royaume-Uni, selon l’enquête participative « Bugs Matter », dont les conclusions ont été publiées le 30 avril. + 80 %C’est le…
Désir et politique font-ils bon ménage ? Pas vraiment, à première vue : ne vivons-nous pas à l’heure du capitalisme libidinal qui, ayant appris à…

« Le référendum, c’est comme une arme nucléaire »François Patriat, sénateur Renaissance, sur l’antenne de la chaîne de télévision Public Sénat, le 6 mai« Le référendum privilégie d’emblée la résolution des problèmes par…
Alors que s’ouvre le 13 avril la fête de Songkran, dans la province de Nakhon Pathom, en Thaïlande, les policiers chargés d’assurer la sécurité de l…

A priori, tout oppose l’abstraction philosophique et la vie toute concrète de l’animal. C’est pourtant par le biais d’un bestiaire bavard que La Fontaine entendait délivrer certaines vérités sur notre condition et dégonfler l’orgueil humain. Nous…
Choix de la rédaction
Robert Francis Prevost est devenu le 267e pape de l’Église catholique sous le nom de Léon XIV. Nicolas Tenaillon, auteur de Dans la tête…

Alors qu’Israël envisage de s’emparer de Gaza, le philosophe palestinien Sari Nusseibeh alerte sur la remise en question de l’existence même de la…

Emmanuel Macron s’apprête à lancer une convention citoyenne pour répondre à cette question que personne, ou presque, ne lui pose. Et pour cause…

Alors que les parlementaires débattent de l’opportunité de réguler l’installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux en France,…

Portrait
À l’occasion de la parution en France de ses livres Futur ancestral et Le Réveil des peuples de la Terre, ce défenseur des peuples autochtones du…

Reportage
Le Bangladesh est l’un des pays qui compte le plus grand nombre de mariages arrangés au monde. Afin de comprendre les rouages de ce phénomène, qui…

Jeux de stratégie
Les Français recevront dans les mois qui viennent un livret sur la conduite à tenir en cas de catastrophe – guerre comprise. Mais peut-on…

Nouvelles vagues
Par crainte des canicules, les destinations ensoleillées ne font plus vraiment rêver les vacanciers qui leur préfèrent la fraîcheur des sous-bois,…

Là est la question…
LE DILEMME DE JEAN-LOUIS« Je travaille en binôme avec un homme qui refuse d’entendre mes arguments. Présent dans l’entreprise depuis plus longtemps que…
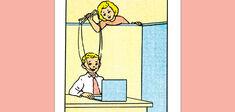
Entretien
Alors qu’il fait paraître plusieurs livres cette année, dont Parler avec sa mère (Flammarion, 2025), l’écrivain et philosophe Maxime Rovere…

Dialogue
C’est l’histoire d’une rencontre entre la philosophe Claire Marin et l’artiste contemporaine Jeanne Vicérial. La première a fait des ruptures et…

Vertiges
Quatre-vingts ans après la tragédie, comment imaginer que l’explosion de la seconde bombe atomique sur le Japon ait été provoquée par la…

Dossier
Comment se changer les idées ?
Publié leQue l’actualité du monde nous inquiète – du réchauffement des conflits à celui du climat – ou que nous affrontions des épreuves sur le plan personnel, nous autres humains ne pouvons pas regarder sans cesse le négatif en face. Le divertissement, avec ce qu’il a de frivole et d’inconstant, n’a jamais eu la faveur des philosophes. Et pourtant, la philosophie n’est-elle pas une discipline qui promet d’agir directement sur nos idées ?Parcours de ce dossier➤ Pour commencer, nous nous sommes demandé comment les intellectuels s’y prenaient quand ils avaient la tête encombrée de soucis. Du chercheur en neurosciences Albert Moukheiber qui joue aux jeux vidéo à la philosophe Fabienne Brugère qui pratique la natation, cinq d’entre eux livrent la clé de leur délassement.➤ Pour échapper à la rumination sans devenir écervelé, il y a trois voies possibles : s’arracher à la situation déplaisante, s’en évader par l’imagination ou encore changer de vision du monde. Ce dossier va explorer chacune de ces voies.I. S’ARRACHER➤ L’arrachement, pour commencer, avec un double reportage en parallèle dans une salle de sport et un club de nuit : et si l’évacuation des pensées obsédantes passait par le corps et la sueur ?II. SÉVADER➤ L’évasion, ensuite : le réalisateur Michel Hazanavicius, qui a récemment sorti au cinéma La Plus Précieuse des marchandises et en librairie ses Carnets d’Ukraine, évoque les pouvoirs de la fiction dans un dialogue étonnant avec le philosophe spécialiste d’esthétique Jean-Marie Schaeffer.III. SE DÉCALER➤ Le décalage, enfin : la philosophe Jeanne Burgart Goutal nous explique comment le yoga l’a amenée à voir la réalité à travers de nouvelles métaphores.➤ Martin Legros nous propose, dans une leçon de philosophie personnelle, de puiser chez Platon, Husserl ou Bergson un renouvellement de notre inspiration.➤ Pour conclure, nous vous invitons au dépaysement, avec une préface à des extraits des Forêts du Maine de Henry David Thoreau.

Renouer avec son corps, ses sens, avec le goût du jeu ou de la pensée, les philosophes que nous avons interrogés vous livrent leurs secrets pour s…

Affronter le monde dans sa brutalité mène souvent au désespoir, voire au ressentiment. Peut-être est-il temps, pour reprendre souffle, de…

Le jour dans une salle de sport, la nuit sur une piste de danse, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui se jettent à corps perdu…

Du rire aux larmes, le cinéaste Michel Hazanavicius n’a pas son pareil pour susciter l’émotion chez le spectateur. Un pouvoir de la fiction qu…
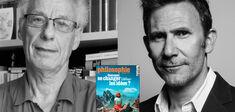
Le yoga est une pratique qui interroge notre rapport à la rationalité et nous permet de nous transformer. Pour la philosophe et professeure de…

Changer en modifiant l’idée que l’on se fait de soi-même, de la vie ou de ce qui nous entoure, ce pourrait être la définition de la philosophie…

Pour prolonger la thématique de notre dossier, nous vous proposons une préface de François Specq, spécialiste de littérature des États-Unis, des…
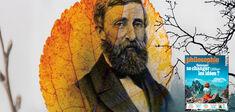
Les clés d’un classique
Critique de la société d’abondance et icône de Mai-68, Herbert Marcuse a été jeté aux oubliettes. À tort. Inspirée par Marx, Freud et Heidegger,…

La société industrielle et de consommation a anesthésié notre capacité à protester et à nous révolter, rendant caduque toute métamorphose sociale…

Livres
Dans un chapitre de Tristes Tropiques (1955) intitulé « La leçon d’écriture », Claude Lévi-Strauss raconte comment, lors d’une expédition en Amazonie…
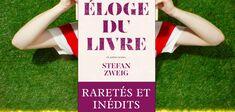
“Un historien à Gaza”, de Jean-Pierre Filiu : vivre dans l'effondrement
Publié lePour comprendre encore quelque chose de Gaza, il fallait entrer dans ce territoire mutilé par des mois de siège et des années de blocus. Une nuit de décembre 2024, l’historien Jean-Pierre Filiu a réussi ce qu’aucun reporter n’est parvenu à faire. Il pénètre par la zone tampon du territoire de Rafah, dans ce qu’il appelle une « cloche hermétique », et y reste trente-deux jours . Il raconte : « Les phares de la jeep serre-file étalent nos ombres le long de la trouée d’asphalte. Le silence n’est troublé que par le ronron lancinant des moteurs, le crépitement des radios en hébreu et le roulement de nos valises sur le goudron militaire. » Écrit comme un carnet, Un historien à Gaza reconstitue un quotidien inimaginable, dont les statistiques relevées par l’auteur – 2,3 % de la population gazaouie tuée depuis octobre 2023, 87 % des habitations détruites, 85 % de la population déplacée… – ne peuvent pas rendre compte. Filiu commence par restituer l’univers sonore : d’abord, le bourdonnement entêtant des drones israéliens, les rafales d’armes automatiques dont la distance est évaluée en une fraction de seconde – à plus de 200 mètres, c’est « loin ». Puis le chant des coqs à l’aube, la détonation des frappes aériennes et des pilonnages d’artillerie qui persécutent ces passants errant sur la route côtière. Ces derniers n’entendent même plus les klaxons des quelques véhicules roulant au pas sur le peu de routes encore praticables. Pourtant, sur la bande littorale d’Al-Mawasi où s’entassent 1 million de déplacés, la vie est là, avec des cafétérias et des salons de coiffure. Le tout sans chauffage, sans carburant, sans eau, sans électricité, dans une « mer de tentes » où chacun dispose de son 1,5 mètre carré sur la boue ou le sable.Dans un monde effondré qui échappe – on ne sait comment – à la « décompensation collective », l’espace public a perdu tous repères usuels. Entre un no man’s land et une zone humanitaire, on habite dans les cimetières ou les écoles. Bien sûr que les objets ont mille vies, que les roues de vélo font tourner les machines à coudre. Mais le plus saisissant réside dans cette façon qu’a un groupe d’humains de réduire son existence à son plus grand malheur. Quand l’humidité tyrannise plus que la faim, les querelles politiques entre des représentants politiques dont les mandats sont tous obsolètes – du président de l’Autorité palestinienne aux députés du Hamas – importent moins que le prix des cigarettes, même vendues par moitié. L’historien et ex-diplomate documente la vie à Gaza par des séjours réguliers depuis les années 1980, mais ce témoignage est, au-delà de la description, un voyage aux frontières de la société humaine, là où la justice est devenue une idée bien futile. Les prisons ont été ouvertes depuis longtemps, et les pillards des rares convois humanitaires ont désormais leurs propres marchés, comme à Deir el-Balah. La leçon de Filiu est que, sur une terre sans État, il n’y a pas de guerre de tous contre tous comme le professaient les philosophes libéraux, Thomas Hobbes en tête. Entre deux ordres d’évacuation, la vie s’organise encore, mais en apnée, dénudée de tout ce qui ne fait pas tenir un jour de plus : la contestation politique, le besoin de justice, la pensée pour ces morts pourtant omniprésents. Il conclut : « On s’écarte aujourd’hui par réflexe, on préfère détourner le regard, on a déjà tellement de peine à porter, on étouffe de tant de deuils refoulés, on pouvait autrefois se sentir solidaires et unis, on peine dorénavant à assurer le minimum vital à sa chair et son sang, on se replie sur les plus proches pour se décharger d’une intenable responsabilité, on réduit son horizon à sa seule tente ou à la pièce où l’on a échoué. »
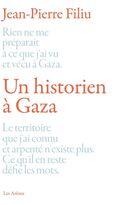
Et si les émotions étaient la nouvelle clé de lecture pour comprendre la société et la psyché contemporaines ? C’est l’hypothèse forte que…

“La Pensée mersive”, de Bruce Bégout : atmosphère, atmosphère…
Publié leVoici une belle anecdote. Lors d’un cours consacré au thème de la nuit, un étudiant questionne son professeur spécialiste de phénoménologie : qu’est-ce qui distingue le jour de son contraire ? Piqué au vif, le professeur improvise une réponse qui tient en un mot : « l’ambiance ». Dix ans après cette scène qu’il décrit comme un « choc » de pensée, Bruce Bégout publie Le Concept d’ambiance (Seuil, 2020), livre aussi imposant qu’exigeant. De cette somme, le présent ouvrage est comme le prolongement ou l’appendice. Si le sujet reste le même, la focale change : alors que le précédent traité visait à décrire de près les ambiances telles qu’elles apparaissent, à dégager leurs traits spécifiques – le fait qu’elles n’ont pas de frontières spatiales et temporelles bien délimitées, par exemple –, il s’agit maintenant de prendre du champ et de cerner le concept d’ambiance en le différenciant de notions en apparence voisines. Bégout commence par la notion de climat. Là où celui-ci renvoie à une réalité météorologique extérieure, l’ambiance, elle, correspond plutôt à la manière dont ces données nous affectent en profondeur. Soit un jour de brouillard et le cafard qu’il inspire : dans ce cas, ce n’est pas le brouillard qui cause mécaniquement le cafard ; le cafard est plutôt lié à une ambiance plus globale et diffuse, à « la totalité vécue de l’environnement lui-même ». Parmi les autres notions abordées, celle de paysage : il est cette portion du monde que nous contemplons de loin, alors que toute distance est abolie par l’ambiance, saisissante et enveloppante. Ce qui n’empêche pas certains paysages de susciter une ambiance : alors nous éprouvons une « affinité » avec le monde déployé lui-même. Pour reprendre le terme technique employé, que d’aucuns jugeront un peu jargonnant, l’ambiance est inséparable de la « mersion » : le fait d’être plongés, de sentir son « appartenance » au tout. Qu’elles soient sereines ou angoissantes, les ambiances toujours nous happent, nous fondent dans ce qui nous entoure, comme la nuit.
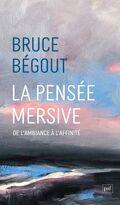
“Wanted”, de Philippe Claudel : le nouveau far-west
Publié le« Zéro plus zéro égale la tête à Toto », fredonnent les écoliers. La tête à Poutine, chez Philippe Claudel, vaut un poil plus cher : un milliard de dollars, payés rubis sur l’ongle par Elon Musk. Telle est la promesse faite par l’homme le plus riche du monde dans la scène d’ouverture de cette dystopie hyper-réaliste. Mais n’en révélons pas davantage, tant la suite réveille le plaisir enfantin de se faire peur en tournant les pages. Faussement simple, le pamphlet s’avère diaboliquement ficelé. Contentons-nous donc d’annoncer une allocution du maître du Kremlin à « l’humanité entière », et de prévenir le lecteur que cette fable n’est pas seulement angoissante, mais aussi très drôle. Il faut dire que ses modèles, du patron de Tesla (les bras toujours encombrés d’un bébé nommé 2025-XY ou Gaïa-Space qui lui vomit dessus) au clown orangeâtre présidant les États-Unis, ne réclament pas de grossir excessivement le trait. « J’ai un cerveau bien supérieur à la moyenne, fait éructer Claudel à Trump. Si je vous donnais mon QI, vous n’en reviendriez pas. Je suis un génie stable. » Ne manque que le « Merdre ! » de Père Ubu. Jarry n’est pas loin. Et Barjavel non plus.Comme chez le grand poète de science-fiction, la fable politique se mue ainsi en rêverie poétique. Par exemple, lorsque l’homme le plus puissant du monde décide d’interdire la mort par décret. Ou que le romancier oppose les « algorithmes des réseaux sociaux – ces inventions goebbelsiennes de la propagande 2.0 » à ce « crépuscule tout en notes roses et touches pâles, qui souligna de feu, jusqu’à ce que la nuit apaise de noir le ciel et la terre, les lignes des montagnes ». Claudel sait toutefois que la poésie ne vaincra pas le néofascisme. L’auteur des Âmes grises et du Rapport de Brodeck a assez médité les guerres pour donner l’alerte face au glissement vers une barbarie mondialisée. Sur la haine du savoir, le dogme de la bêtise, ou le primat de l’argent sur la morale, son constat est sans appel. Et ses charades pertinentes : « Qui de Trump ou de Musk [est] le pantin et le marionnettiste ? » Quant à savoir où est le bien, où est le mal, cette question n’a plus aucune importance tant qu’a eu lieu « un grand moment de télévision ». Le conte de notre époque n’est plus Candide – mais Sordide.

“Physique existentielle”, de Sabine Hossenfelder : mortel n’est pas quantique
Publié le« Est-ce que ma grand-mère est encore vivante grâce à la mécanique quantique ? » C’est à ce genre de questions que Sabine Hossenfelder, spécialiste de physique fondamentale à l’Institut d’études avancées de Francfort, avoue se trouver régulièrement confrontée. Des questions concrètes, de nature « métaphysique » ou « existentielle », et donc a priori éloignées de son domaine d’expertise, mais sur lesquelles pourtant, elle en est convaincue, la physique a son mot à dire. Il relève même du devoir des scientifiques de s’emparer de ces inquiétudes, estime-t-elle, car s’ils renoncent à s’engager pour rester enfermés dans leur laboratoire, ils s’exposent à laisser le terrain libre aux pires des charlatans de toute sorte. Sur un ton à la fois très libre, pédagogique et souvent prudent, Sabine Hossenfelder vulgarise ainsi la théorie de « l’univers-bloc » et de la constante cosmologique, aborde le problème de la réalité des mathématiques et des trous noirs, ceux de l’existence du libre arbitre, de la naissance de l’Univers ou encore de l’irréversibilité du temps.Les réponses qu’elle apporte sont à la fois précises et accessibles au grand public. Elle nie, par exemple, que nous soyons réductibles à un « tas » de particules élémentaires dans la mesure où ce qui nous caractérise n’est pas notre matière mais l’agencement, les relations extrêmement complexes de nos constituants – à cet égard, elle soutient l’hypothèse que nous resterions nous-mêmes si chaque neurone de notre cerveau était remplacé par une puce en silicium harmonieusement interconnectée avec toutes les autres… Et votre grand-mère dans tout ça, insistez-vous ? « La physique de la relativité restreinte d’Einstein nous interdit de limiter l’existence à un seul instant qu’on appelle “maintenant”, explique la physicienne. Or, si tous les instants existent pareillement, nos ancêtres – ainsi que nos grands-parents – vivent en ce moment comme nos parents actuels. » De quoi donner à repenser la condition humaine ?
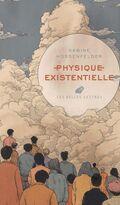
“Microvoyage”, de Rémy Oudghiri : apologie de la dérive
Publié leVous n’avez pas encore planché sur le programme de vos vacances ? Rassurez-vous : il n’est point besoin de filer loin pour voyager. Ni de partir longtemps. Ni même de planifier à l’avance. Et encore moins de pister les balises photogéniques agitées par les guides touristiques. À l’instar des haïkus, ces petits poèmes japonais, ce qui est court n’en est pas moins riche, défend Rémy Oudghiri dans un court essai vivifiant sur les « microvoyages ». Il y poursuit sa quête d’instants volés à l’ordinaire commencée dans son précédent ouvrage L’Échappée belle (PUF, 2023). La recette du microvoyage est simple : sortir de chez soi, sans objectif particulier en tête et se laisser aller au gré des découvertes. Car voyager ne consiste pas à « cocher les cases les unes après les autres dans une sorte de vertige du néant » mais relève d’une certaine attitude à rendre présent ce qui nous entoure. Non pas seulement en accordant aux choses ordinaires une attention accrue, mais surtout en se laissant happer par elles. Guidé par les pas des promenades de Rousseau comme par les utopies urbaines de Guy Debord, l’auteur touche au plus juste lorsqu’il convoque le poète suisse Philippe Jaccottet, « exemple parfait de microvoyageur ». « Convaincu qu’il est inutile d’aller loin », Jaccottet ramène de ses promenades des émotions d’autant plus vives qu’il ne cherche pas à s’y attarder : « une attention trop soutenue, à force de nous mobiliser, peut nous empêcher d’être disponible. Il faut être capable d’accueillir cet instant, mais aussi de le laisser s’échapper ». Si l’on passe outre quelques mièvreries – l’auteur promet au microvoyageur le « bonheur » ou le « paradis » –, ce contre-manuel de voyage propose une salutaire apologie de la dérive à l’heure de l’ultraplanification de nos vies. Laissez-vous aller, c’est la meilleure manière de vous guider.

“Que sommes-nous ?”, d’Eric T. Olson : en quête de propriétés
Publié leY a-t-il question plus monumentale que celle de savoir ce que nous sommes ? En deux mille cinq cents ans, les philosophes ne l’ont pas épuisée, à tel point que le combat définitionnel semble perdu. Eric T. Olson, philosophe américain enseignant en Angleterre, à l’université de Sheffield, s’arme de son bagage analytique pour la réactualiser. Dans une argumentation méthodique et enjouée, l’auteur décompose les difficultés du problème à travers une série de réfutations nourries, sinueuses, souvent déroutantes. Il dégage sept grandes possibilités, comme autant de pelotes de laine à démêler. Nous serions des animaux, des choses, des cerveaux (pour la partie matérielle), mais aussi des morceaux de temps, des états mentaux, des âmes… et peut-être même rien du tout. Les auteurs classiques, tels que Locke et Hume (qu’il préfère au premier), côtoient des philosophes plus méconnus sur le continent, que le lecteur se plaît à rencontrer, à défaut de toujours les comprendre : Shoemaker, Rovane, Lewis, Strawson, Wiggins… Le « constitutionnalisme » dialogue avec le « quadridimensionalisme », la « doctrine du soi sans propriétaire » croise l’« ontologie clairsemée ». Des moitiés de cerveaux gambadent dans des laboratoires, une statue d’argile, un exemplaire de Moby Dick corné ou un ordinateur en panne deviennent des supports de méditation insoupçonnés. Et Olson, dans tout ça ? Sa préférence va à l’« animalisme », l’idée que nous serions métaphysiquement des organismes, c’est-à-dire des « particuliers concrets » capables de « persister sans continuité psychologique ». En somme, la pensée ne nous définit pas. Pas si évident, venant d’un homme capable d’écrire : « Quel genre de chose est un chien endormi, et quelle relation a-t-il avec un chien ordinaire qui peut être endormi ou non ? » C’est vrai, tiens : qu’en pensent les chiens ?
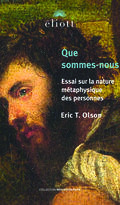
“Le Monde par les hiéroglyphes”, de Christophe Barbotin : penser comme un pharaon
Publié le« Les médecins égyptiens n’avaient pratiquement rien compris à la physiologie du corps humain ni à son fonctionnement, alors qu’on ouvrait dans le même temps des milliers de cadavres pour en faire des momies. » Comment est-ce possible ? C’est que, souligne Christophe Barbotin, le « mode de pensée » égyptien n’a rien à voir avec le nôtre, qui se tient dans l’horizon de l’objectivité scientifique. « Un observateur scientifique s’attache à dépasser l’apparence pour découvrir la substantifique moelle qui se cache derrière elle. » L’observateur est actif : il cherche à comprendre, à rendre compte de l’expérience en dévoilant ce qui se cache derrière son voile. Au contraire, dans la « pensée hiéroglyphique », « l’apparence vaut pour réalité ». Et le « regardeur » est passif, effacé. La pensée égyptienne ne se déploie pas dans l’abstraction mais dans un monde concret de formes bigarrées. Cette inscription dans les apparences ne va pas sans une stylisation prononcée. Il suffit d’une « jambe gauche » pour « exprimer la capacité de la marche », là où les Grecs s’emploieront à représenter précisément, de manière réaliste, le « mouvement en train de se faire ». Les « gestes standardisés », à la racine des hiéroglyphes, condensent l’apparence : ils figurent les choses « de manière absolue, donc en soi », indépendamment d’un témoin situé dans l’espace et dans le temps. Tel est le principe de la pensée « aspective » par opposition à l’approche « perspective ». La domination de l’aspective explique qu’« en Égypte, la notion même de science était inconnue », malgré un goût pour le calcul et les classifications. « Ce n’est pas qu’ils furent incapables de comprendre, c’est tout simplement qu’ils n’eurent pas l’idée de chercher à comprendre. »

“Les Rêves et le Temps”, de María Zambrano : clés d’envoûtement
Publié leSi Freud entendait interpréter la signification des rêves, c’est tout autre chose qu’entreprend María Zambrano, figure de la philosophie espagnole du XXe siècle : saisir, indépendamment des contenus oniriques particuliers, la place du rêve dans la dynamique de l’existence. « Toute situation de veille, remarque-t-elle, a lieu parce que nous l’avons plus au moins voulu, prévu ou cherché […] ; nous sommes en train d’aller vers quelque chose. […] Dans les rêves c’est l’inverse ; ce sont eux qui se présentent à nous. » Le rêve est un « sortilège » qui « envoûte » : le dormeur y est entièrement absorbé, enfermé. « L’endurance, la passivité, s’offre dans les rêves […] à l’état pur. » Pour décrire cet état, Zambrano parle d’« a-temporalité », formule qui pourrait prêter à confusion : il y a bien, dans le rêve, un devenir, mais ce devenir n’a rien à voir avec le temps de la conscience éveillée. Dans le rêve, les images se succèdent implacablement comme si l’histoire fantasmagorique était écrite d’avance. Quelque chose se passe, sur quoi le dormeur, pur spectateur, n’a pas de prise. Le sujet diurne, au contraire, exerce une maîtrise sur le temps : il peut suspendre, par un recueillement intérieur, le défilé des images, se rapporter à des vécus passés ou les exiler dans l’oubli, et se projeter vers l’avenir. Le rêveur lui est dépouillé de cet usage du temps. Il ne faut pourtant pas en déduire que les deux états n’ont aucun rapport l’un avec l’autre. C’est tout le contraire. Le dormeur sans rêve est « immergé à l’intérieur de quelque chose d’immense, d’obscur, d’invisible » – le mouvement aveugle de la Vie. Il retourne « à la situation prénatale ». Dès qu’il commence à rêver, cependant, émerge quelque chose comme un sujet qui se séparera plus radicalement à l’éveil. Ainsi, « dans les rêves, nous assistons à la genèse de la conscience ». Chaque nuit, l’entre-deux du rêve est en même temps un précieux rappel de ce que la conscience volontaire reste toujours enracinée dans un flux vital plus large que l’esprit éveillé, inévitablement, fragmente.

Arts
« Pour que la justice soit faite de façon juste, il faut suivre des règles qui parfois nous empêchent de rendre justice. » Cette repartie, le…

Un professeur d’Oxford s’est rendu chez Freud, à Londres, quelques jours avant sa mort. Cette information est documentée, mais l’identité du visiteur reste…

Ashaninka, Kayapo et Wayana-Apalaï : ces trois peuples sont au cœur du musée des Confluences. Amazonies, s’intitule l’exposition qui montre leurs…

Comme des grands
Questionnaire de Socrate
Il pratique le cinéma comme d’autres la « magie », avec l’excitation de voir apparaître sur l’écran, dans la succession des plans, ce…

