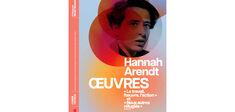Aurore Mréjen : « Seule l'action politique instaure un lien entre les êtres humains »
Individualisme, solitude, crise de l’autorité et aliénation du monde : voilà le diagnostic que porte Hannah Arendt sur son époque avec, pour corollaire, plus de consommation et moins d’engagement politique. C’est ce que la philosophe, analyse Aurore Mréjen, invite à inverser.
Individualisme, disparition de l’autorité, anomie, « épidémie » de solitude... Comment l’idée arendtienne d’« aliénation du monde » explique- t-elle les pathologies des sociétés modernes ?
Pour Arendt, l’époque moderne se caractérise par une aliénation par rapport au monde. Elle se distingue en cela de Karl Marx et de son analyse sur l’aliénation du moi, qui projette ses propres qualités génériques dans le travail, lequel lui devient ensuite étranger par une opération de dépossession. Chez Arendt, l’aliénation se comprend comme détachement du monde. Elle prend la forme d’une position d’exil, de fuite, d’expropriation et de séparation radicale d’avec le monde commun conçu comme horizon de toute existence humaine plurielle, partage des expériences sensibles et lieu d’un possible dialogue selon un langage commun. L’éloignement et la distance par rapport au monde dessinent un devenir étranger à ce monde. Ne s’y sentant plus chez lui, l’être humain se replie sur lui. Dans la société de masse, le monde qui est « entre » les gens n’a plus le pouvoir de les rassembler, de les relier ou de les séparer. Ce qui peut expliquer l’hyperindividualisme, l’atomisation, ou l’« épidémie » de solitude des sociétés modernes, dans lesquelles l’individu est plus facilement porté à la consommation solitaire qu’à l’engagement politique expérimenté avec d’autres.
Les grandes révolutions politiques promettaient une forme de libération. Le délitement du monde est-il lié au dévoiement de cet idéal de liberté ?
Aurore Mréjen — Dans l’introduction à son Essai sur la révolution, Arendt écrit que la liberté « est et a toujours été le but de la révolution ». Elle distingue la révolution américaine de 1776 – politique – et la Révolution française de 1789 – économique. En France, la Révolution s’est d’emblée éloignée du chemin de la fondation politique du fait de la place prépondérante prise par la souffrance des malheureux. De sorte que la liberté d’action s’est mise au service de la libération face à la tyrannie de la nécessité. Mais l’estime d’Arendt pour la révolution américaine n’est pas sans limite car elle a aussi été victime d’une perversion par rapport à son intention première, la question économique ayant recouvert les expériences politiques originaires. Pour autant, chaque révolution a eu pour conséquence de faire apparaître les éléments d’une forme de gouvernement entièrement nouvelle (même si elle ne s’est pas concrétisée de façon pérenne), qui procède du processus révolutionnaire lui-même, c’est-à-dire de l’action libre et spontanée de celles et ceux qui y participent. Arendt souligne que les possibilités de l’action n’ont pas disparu, ce qui signifie que la liberté politique demeure à conquérir chaque jour et qu’elle relève de notre responsabilité.
Elle considère la consommation frénétique comme une manière compulsive de combler un vide existentiel ?
A. M. — Chez Arendt, la consommation et l’activité de travail sont deux stades d’un même processus imposé à l’homme par la nécessité de la vie. Dire que nous vivons dans une société de consommateurs revient à affirmer que nous vivons dans une société de travailleurs. Avec la modernité, l’activité de travail est devenue prédominante et a pris le pas sur les autres (l’œuvre et l’action). La société moderne est devenue une société de travailleurs ou d’employés dans la mesure où « tous ses membres considèrent leur activité, quelle qu’elle soit, comme essentiellement un moyen de gagner leur vie et celle de leurs familles ». Les activités sérieuses reçoivent le nom de travail et celles qui ne sont nécessaires ni à la vie de l’individu ni au processus vital de la société deviennent des « passe-temps » ou des amusements. Même l’« œuvre » de l’artiste tend à se dissoudre dans le jeu et à perdre son sens pour le monde. De plus, avec le progrès technologique, les deux stades par lesquels passe le cycle perpétuel de la vie biologique, celui du travail et celui de la consommation, peuvent changer de proportion pour arriver au point où presque toute la « force de travail » de l’être humain se dépense à consommer, posant ainsi non seulement la question du temps « vide » laissé à une consommation exacerbée, mais aussi celle du chômage de masse. Le risque est alors de vivre dans une société de travailleurs privés de travail, qui ont perdu de vue les activités « plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner cette liberté » et se noient dans la consommation. Néanmoins, les sphères d’activité « essentielles » n’ont pas été supprimées et il nous appartient de les réinvestir.

Pour Aurore Mréjen, spécialiste de l’œuvre de Hannah Arendt, l’autrice de Condition de l’homme moderne permet de réfléchir aux implications d’une…
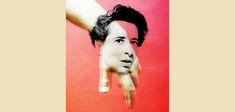
Dans le passionnant Cahier de l’Herne qu’elles ont dirigé, Martine Leibovici et Aurore Mréjen ont rassemblé un très grand nombre de textes et d…

À l’occasion de la publication du Cahier de l’Herne consacré à Hannah Arendt et dirigé par Martine Leibovici et Aurore Mréjen, nous publions avec…
![© Münchner Stadtmuseum, Sammlung Fotografie, Archiv Niggl Radloff [Exclusif] Hannah Arendt : “Avoir l’esprit politique, c’est se soucier davantage du monde que de nous-mêmes”](assets/images/arendt_fond_jaune.jpg)
À l’occasion de la publication du Cahier de l’Herne consacré à Hannah Arendt et dirigé par Martine Leibovici et Aurore Mréjen, nous publions avec…
![© Éditions de l’Herne © Münchner Stadtmuseum, Sammlung Fotografie, Archiv Niggl Radloff [Exclusif] Hannah Arendt : “Le délitement de l’autorité”](assets/images/couv_cahierarendt.jpg)
À l’occasion de la publication du Cahier de l’Herne consacré à Hannah Arendt et dirigé par Martine Leibovici et Aurore Mréjen, nous publions avec…
![[Exclusif] Hannah Arendt : “La cybernétique et la révolution du travail” [Exclusif] Hannah Arendt : “La cybernétique et la révolution du travail”](assets/images/arendt_fond_rouge.jpg)
Pour la philosophe Sandra Laugier, l’amour et l’amitié sont des liens forts, tandis que la vie collective repose sur les liens faibles, entre des personnes qui se connaissent à peine, dans les lieux publics ou sur les réseaux sociaux,…
L’amitié peut-elle être un modèle pour l’action politique ? D’un côté, l’idéal grec et romain d’amitié entre les hommes de la Cité, perpétué par Rousseau ; de l’autre, le machiavélisme des Modernes, pour qui les intérêts…
Spécialiste de philosophie morale et politique, Michel Terestechenko explique ici, en préface aux extraits de « Le travail, l’œuvre, l’action…