“Dans les séries, on associe le Moyen Âge à la guerre pour mieux dépeindre notre présent comme ‘civilisé’”
Les séries télévisées et les jeux de guerre véhiculent une image bien souvent tronquée de l’histoire. Comment l’expliquer ? Samedi 15 mars, deux conférences à la Cité des sciences, à Paris, tenteront d’y répondre. Justine Breton, maîtresse de conférences en littérature comparée à l’université de Lorraine et spécialiste des fictions médiévales, nous en dit plus.
« Séries et jeux vidéo : la guerre mise en scène » : une après-midi de conférences à la Cité des sciences et de l’industrie, à Paris. Accès gratuit, sur réservation, également disponible en ligne pour les personnes à distance, à cette page. Un événement en partenariat avec Philosophie magazine.
Les séries qui situent leur intrigue au Moyen Âge (ou dans une époque apparentée) connaissent un grand succès : Game of Thrones, Vikings, The Last Kingdom, The Witcher, Les Anneaux de pouvoir, House of the Dragon... Comment l’expliquer ?
Justine Breton : Le Moyen Âge ne nous a jamais véritablement quittés. Bien qu’éloignée temporellement, cette période de l’histoire nous semble familière. De fait, il existe de nombreux vestiges liés au Moyen Âge et le public est attaché à certains legs, comme les cathédrales, les châteaux... Par ailleurs, les chercheurs qui l’étudient découvrent sans cesse de nouvelles choses, ce qui donne envie aux créateurs d’imaginer toujours plus de récits autour. Certains récits se veulent fidèles à la réalité, d’autres sont volontairement plus fantaisistes. Un des clichés récurrents sur le Moyen Âge dans la fiction, particulièrement les séries télévisées, est le fait d’associer les intrigues à la guerre – soit une guerre qui se prépare, soit qui a eu lieu, soit qui est en cours. C’était déjà le cas avec les premières créations à partir des années 50 : Guillaume Tell, Ivanhoé, Thierry la Fronde, etc. Même Les Piliers de la Terre, adapté d’un roman de Ken Follett, qui évoque la construction d’une cathédrale et la vie quotidienne des paysans, se déroule sur fond de guerre.
“Les chercheurs qui étudient le Moyen Âge découvrent sans cesse de nouvelles choses, ce qui donne envie aux créateurs d’imaginer toujours plus de récits autour”
Comment comprendre cette omniprésence de la guerre, selon vous ?
Certains conflits ont marqué les imaginaires, comme la guerre de Cent Ans (qui a en fait duré 116 ans, avec de longues périodes de pause). On peut aussi attribuer cette omniprésence à l’historiographie, qui a très longtemps insisté sur les grandes dates de l’histoire médiévale, donc les guerres et les couronnements, principalement. Cette vision de l’histoire était largement orientée par la vie militaire, et il a fallu du temps pour que les travaux montrent en détail des éléments d’une autre nature, comment les gens travaillaient, interagissaient, se divertissaient, quelles étaient leur sensibilité ou leur imaginaire. Malgré la progression des connaissances, le Moyen Âge reste trop souvent associé à une époque sombre. Et déjà, visuellement : plus vous remontez le temps, dans les séries, et plus le filtre désature l’image qui devient terne… À croire qu’au Moyen Âge, il faisait nuit tout le temps (House of the Dragon, à ce titre, pousse vraiment les curseurs à fond) ! Et qui dit pénombre, dit violence. Mais les gens ne réglaient pas tous les litiges à la pointe de l’épée. Il existait un système judiciaire et administratif très développé au Moyen Âge. Les séries ont tendance à le passer sous silence.
Pourquoi cette simplification historique ?
Les créateurs de séries – dont nombre sont adaptées de romans – aiment faire du Moyen Âge un temps historique lui-même attaché à la simplicité, un temps d’avant l’industrialisation, la mondialisation, la spécialisation, l’hyperconnexion, où l’être humain était (supposément, en tout cas) moins sollicité et perdu qu’aujourd’hui. Cette lecture simpliste implique des lectures parfois problématiques, puisque c’est aussi un moyen de célébrer une organisation sociale où chacun connaissait sa place, où les hommes avaient le rôle de dominant, les femmes celui de subordonnées. C’est aussi faire du Moyen Âge une période figée, une longue frise de mille ans d’histoire où rien n’aurait évolué, pas de progrès technique ni scientifique, peu de productions artistiques, un rejet des apports de l’Antiquité. C’est là encore faux ou exagéré. Il suffit de se référer à la Renaissance du haut XIIe siècle, théâtre d’une explosion artistique incroyable, pour s’en persuader.
“Il existait un système judiciaire et administratif très développé au Moyen Âge. Mais les séries aiment faire de cette époque une période figée, attachée à la simplicité, sans évolution, où l’être humain aurait été moins perdu qu’aujourd’hui…”
Vous montrez, dans vos travaux, que ces idées reçues concernent aussi la vision du peuple et l’exercice du pouvoir.
Certaines représentations ont durablement marqué les imaginaires, non sans faire quelques dégâts ! Un film comme Les Visiteurs, de Jean-Marie Poiré, certes très drôle, met en scène un paysan, Jacquouille, qui a les dents gâtées. Sauf que les dents gâtées, c’est à cause du sucre, et qu’au Moyen Âge, on n’a pas encore de sucre dans l’alimentation... Ce petit exemple en dit long sur la persistance de certains clichés. Dans les séries, la majorité de la population est décrite comme barbare, sans hygiène, assoiffée de sang, politiquement passive. En parallèle, la représentation du pouvoir n’est pas moins schématique. Le souverain serait un tyran qui aurait tous les droits sur le peuple, un peu à la manière d’un Louis XIV sanguinolent. Mais le système féodal limitait fortement ses prérogatives et le rendait très dépendant des barons locaux.
Les séries télévisées décrivent-elles un art de la guerre qui serait propre au Moyen Âge ?
Pas vraiment. Des éléments historiques sont respectés, comme certaines armes ou techniques de combat. La série Vikings par exemple illustre des techniques d’attaque ou de siège assez fidèles à la manière dont les guerriers du Nord se comportaient, d’après ce que l’on en sait – surtout grâce à des sources littéraires, toutefois. Mais globalement, cette question du réalisme est surtout un argument marketing. La fiction reprend généralement le dessus. Il arrive que des pratiques issues d’autres périodes soient associés à l’écran, à commencer par l’Antiquité ou le XXe siècle. Par exemple, dans Game of Thrones, l’épisode intitulé « La bataille des bâtards » a recours à une imagerie qui renvoie clairement à la Première Guerre mondiale et aux guerre de tranchées, avec une guerre de position et des personnages ensevelis sous la terre ou sous des soldats morts. Ces séries préfèrent multiplier les références, piocher un peu dans toutes les époques pour transmettre au spectateur l’horreur de la guerre ou, inversement, son inventivité.
“Disney portait une vision unilatéralement féérique, édulcorée, du Moyen Âge. En réaction, des séries comme ‘Game of Thrones’ sont ultraviolentes. Mais les deux visions sont caricaturales”
Les séries condamnent peut-être l’horreur de la guerre, mais elles sont de plus en plus violentes...
C’est vrai. Ce phénomène paradoxal est notamment dû à l’apparition des chaînes câblées puis des plateformes en ligne, qui permettent de cibler des publics moins familiaux, plus disponibles pour ce genre d’œuvres violentes. Les créateurs de ces séries brutales, parfois même ultraviolentes, ont d’ailleurs fait l’objet de critiques. C’est le cas de George R. R. Martin, auteur de la saga littéraire Le Trône de fer (à l’origine de Game of Thrones), qui avait tendance à dire, au moins au début de sa carrière, quand on lui faisait ce reproche : « Ce n’est pas moi, c’est l’époque qui voulait ça. » Son objectif était de sortir de la vision édulcorée du Moyen Âge, unilatéralement féérique, portée, entre autres, par les productions Disney. Dans l’esprit de cet écrivain, un seigneur ne va pas aider une jeune paysanne à porter son panier, il va davantage essayer de la violer et éventuellement de la décapiter dans un coin. Les deux visions sont caricaturales. Dire que le Moyen Âge était plus violent que notre époque est en réalité une manière de se dédouaner de ce spectacle de la violence.
Ces séries médiévales sont donc d’abord un prétexte pour parler de nous ?
Elles permettent en effet bien souvent de penser le temps présent mieux que le Moyen Âge lui-même. Mais ce n’est pas nouveau. La série française Thierry la Fronde, diffusée dans les années 1960, était l’occasion de parler de la Résistance. Dans The Witcher, dont les romans d’origine (la saga du Sorceleur, en français) sont écrits par le romancier polonais Andrzej Sapkowski, on perçoit de nombreuses allusions à la Seconde Guerre mondiale et aux dévastations humaines et matérielles qui ont touché la Pologne. D’où l’intérêt aussi, parfois, de noircir le trait quand on parle du Moyen Âge, parce qu’il est difficile d’accepter que notre période peut être extraordinairement sombre. On associe le Moyen Âge à la guerre pour mieux dépeindre notre présent comme « civilisé ». En un sens, toutes les fictions historiques sont des miroirs tendus pour observer le présent. On projette sur ces temps anciens nos propres envies, nos propres attentes, nos propres craintes aussi. Aujourd’hui, plusieurs œuvres offrent des relectures féminines du Moyen Âge. Dans House of the Dragon ou Les Anneaux de pouvoir, les femmes sont au centre de l’intrigue, elles ont de la force physique, mentale, elles décident. Ce procédé est très critiqué par les masculinistes. Pourtant, ce n’est pas absurde. L’idée n’est pas de soutenir, contre la réalité historique, que l’intégralité des femmes au Moyen Âge étaient puissantes, mais de montrer que les choses étaient plus compliquées que ça, qu’elles n’étaient pas toutes privées du droit de se battre, de travailler, de montrer sur le trône.
“Toutes les fictions historiques sont des miroirs tendus pour observer le présent. On projette sur ces temps anciens nos propres envies, nos propres attentes, nos propres craintes”
Ces séries guerrières évoluent souvent dans des univers magiques, correspondant au genre de la fantasy. Qu’est-ce que cela apporte en plus ?
La représentation du Moyen Âge est immanquablement liée à celle de la fantasy. On a beau savoir qu’il n’y avait pas véritablement de dragons il y a mille ans, la superposition se fait très vite ! Notre conception du Moyen Âge reste très influencée par des œuvres comme Le Seigneur des anneaux, de J. R. R. Tolkien. La fantasy est un genre héritier du merveilleux, qui, après l’intense industrialisation du XIXe siècle, ajoute une réflexion sur la technique et ses possibles dérives. Elle fait un pont entre ces éléments magiques et, d’une certaine manière, la période des Lumières, qui était, elle, obsédée par la question de la rationalité. La fantasy tente de réinjecter du merveilleux là où le monde en avait peut-être trop perdu. À partir des années 2010, on a eu une vague de fantasy très sombre, avec un merveilleux tendant vers le monstrueux (The Last Kingdom, The Witcher). C’était l’occasion aussi de revenir aux fondamentaux du genre, qui est de questionner la définition du bien et du mal. Tolkien l’avait bien établi dans Le Seigneur des anneaux. Chez lui, l’issue à cette opposition inextricable, c’était l’entraide, la solidarité, le fait de former une communauté. Si l’on écoute Andrzej Sapkowski, c’est davantage la famille, mais la famille que l’on se crée soi-même. L’idée de la fantasy n’est pas de rejeter le progrès technique, la matérialité, l’industrie, mais plutôt de savoir comment mettre en commun les ressources le mieux possible. Car au fond, les fictions médiévales, qu’elles versent dans la fantasy ou pas, sont hantées par une question : comment survivre ? À l’heure de la crise écologique et de la montée des périls, cette préoccupation reste très actuelle.
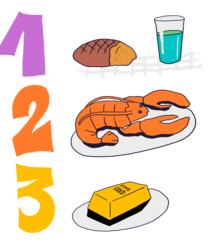
Comment la révolution du télétravail, les nouveaux modes de vie urbains ou encore le culte du sport vont-ils reconfigurer nos villes ? Pour…

Le philosophe Alain s’est engagé en 1914 dans ce qui deviendra la « Grande Guerre », avant d’être réformé en 1917. Profondément marqué…

On peut donner deux sens au mot histoire : ce que l’homme a vécu, et le récit qu’il en fait. En tant que récit, l’histoire suppose l’écriture, dont l’invention marque le passage de la préhistoire à l’histoire. Tournée vers le passé,…
Originellement, c’est une saga romanesque de fantasy, Le Trône de fer, écrite par George R. R. Martin et publiée à partir de 1996. Puis, adaptée sous le nom de Game of Thrones, c’est une série télévisée américaine créée par David…
Extrait – Observateur attentif de la diversité des coutumes de son époque, Montaigne (1533-1592) sut aussi trouver auprès des auteurs anciens matière à se confronter aux pratiques des hommes du passé. Associé à sa philosophie sceptique,…
Après René Girard et Roger Caillois, notre « livre du jour » consacré à la guerre est l’œuvre d’Alexis Philonenko (1932-2018). Dans…
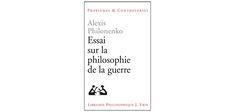
Sa vie n’est pas exactement un Long Fleuve (l’Anduin) tranquille. Natif d’Afrique du Sud, catholique fervent, soldat lors de la Première Guerre mondiale, mari aimant, conteur d’histoires pour ses enfants, philologue renommé, passionné…
Si la guerre en Ukraine marque un événement sans précédent dans l’histoire, c’est parce que, loin de se réduire à l’attaque d’un pays souverain…
