Faire confiance aux hommes
Le 28 octobre 1964, un an après la parution de Eichmann à Jérusalem, la télévision ouest-allemande diffuse un entretien exceptionnel entre Hannah Arendt et le journaliste – futur homme politique et diplomate – Günter Gaus. La philosophe y fait preuve d’une extraordinaire maîtrise de l’articulation entre penser, juger et agir. Extraits.
Günter Gaus — Votre travail est actuellement centré sur la théorie, l’action et le comportement politiques. Compte tenu de cela, j’ai relevé dans votre correspondance avec le professeur israélien Scholem un point qui me paraît particulièrement intéressant. Vous lui écriviez – je me permets de vous citer – que « dans [votre] jeunesse, [vous ne vous] intéress[iez] ni à la politique ni à l’histoire » [Lettre à Gerhard Scholem du 24 juillet 1963, ndlr]. Madame Arendt, vous avez quitté l’Allemagne en 1933 car vous étiez juive : vous aviez alors 26 ans. Y a-t-il un lien de cause à effet entre ces événements et votre préoccupation pour la politique et l’histoire ?
Hannah Arendt — Oui, bien évidemment. En 1933, on ne pouvait plus s’en désintéresser. Il y avait même déjà longtemps que ce n’était plus possible.
G. G. — Et c’était également le cas pour vous ?
H. A. — Oui, bien sûr. Je me suis mise à lire attentivement les journaux et je me suis forgé une opinion. Toutefois, je ne me suis engagée dans aucun parti, n’en ressentant pas même le besoin. Depuis 1931, j’étais intimement convaincue que les nazis allaient prendre le pouvoir et je m’étais fermement expliquée sur ces problèmes avec d’autres personnes. Mais ce n’est qu’au moment de l’émigration que je me suis occupée de tout cela de façon systématique.
G. G. — Je voudrais vous poser une question annexe concernant ce que vous venez de dire. Partant de la conviction qui était la vôtre depuis 1931, selon laquelle les nazis prendraient le pouvoir, vous n’avez pas pour autant tenté de les en empêcher de façon active, en adhérant par exemple à un parti : peut-être estimiez-vous que cela n’avait plus aucun sens ?
H. A. — Personnellement, je ne trouvais pas du tout cela dénué de sens : si tel avait été le cas, encore que ce soit très difficile à dire après coup, j’aurais peut-être fait quelque chose. Mais je trouvais que c’était sans espoir.
G. G. — Pouvez-vous dater votre engagement politique à partir d’un événement déterminé ?
H. A. — Je pourrais parler du 27 février 1933, jour de l’incendie du Reichstag, et des arrestations illégales qui s’ensuivirent au cours de la même nuit. On parlait de « détentions préventives » : vous savez que les gens échouaient en réalité dans les caves de la Gestapo ou dans les camps de concentration. Ce qui commença alors est monstrueux et se trouve souvent occulté de nos jours par des choses plus tardives. Ce fut pour moi un choc immédiat, et c’est à partir de ce moment-là que je me suis sentie responsable. Cela signifie que j’ai pris conscience du fait que l’on ne pouvait plus se contenter d’être spectateur. J’ai cherché à agir dans plusieurs domaines. Mais ce qui m’a entraînée immédiatement hors d’Allemagne – s’il me faut en parler –, je ne l’ai jamais raconté, parce que ça n’a aucune importance...
G. G. — Racontez, je vous prie.
H. A. — J’avais de toute façon l’intention d’émigrer. Je fus tout de suite d’avis que les Juifs ne pouvaient pas rester. Je n’avais pas l’intention de circuler en Allemagne en qualité, pour ainsi dire, de citoyen de seconde zone, ou de quelque autre manière que ce fût. En outre, je pensais que les choses ne pouvaient qu’empirer. Pourtant, je ne suis finalement pas partie d’une manière aussi pacifique. Et je dois dire que j’en ai ressenti une certaine satisfaction. Je me disais : au moins, j’ai fait quelque chose ! Au moins, je ne suis pas tout à fait innocente : personne n’aura le droit de me le reprocher ! Ce fut l’organisation sioniste qui me fournit alors une occasion. J’étais très étroitement liée d’amitié avec quelques-unes des personnalités à la tête du mouvement, et surtout avec le président de l’époque, Kurt Blumenfeld. Mais je n’étais pas sioniste et on n’avait d’ailleurs pas cherché à m’enrôler. Toujours est-il que j’avais en un certain sens subi l’influence du sionisme : notamment dans la critique, ou plus exactement l’autocritique que les sionistes avaient développée au sein du peuple juif. J’en ai été influencée et même impressionnée mais, politiquement, je n’avais rien à voir avec eux. Or, en 1933, Blumenfeld et quelqu’un d’autre, que vous ne connaissez pas, vinrent me trouver et me dirent : nous voulons constituer un recueil de tous les témoignages antisémites de bas étage en vigueur dans toutes les associations, dans toutes les corporations et dans toutes les revues professionnelles possibles, bref tout ce qui est inconnu à l’étranger. Organiser ce recueil tombait alors sous le coup de ce que l’on appelait la Greuelpropaganda, c’est-à-dire une contre-propagande tendant à dénaturer les positions de l’adversaire jusqu’à la diffamation. Aucun membre de l’organisation sioniste ne pouvait bien évidemment s’en charger car, si les choses tournaient mal, il entraînait à sa suite l’organisation à sa perte. Ils me demandèrent donc : « Veux-tu t’en charger ? » et je répondis « Bien sûr ! » J’étais très contente : cela m’avait tout d’abord semblé une excellente idée et, par la suite, j’avais même eu le sentiment que c’était une manière d’agir.
G. G. — Votre arrestation est-elle liée à ce travail ?
H. A. — Oui. C’est alors que je fus arrêtée. Mais j’ai eu beaucoup de chance : je m’en suis tirée au bout de huit jours parce que je m’étais liée d’amitié avec le fonctionnaire de la police judiciaire qui m’avait arrêtée. C’était un type charmant. Originellement membre de la police criminelle, il avait été promu dans la section politique. Il n’avait aucun soupçon. Pourquoi en aurait-il eu ? Il me disait toujours : « D’habitude il me suffit de bien observer la personne assise en face de moi pour savoir aussitôt de quoi il retourne. Mais avec vous, que faire ? »
G. G. — Cela se passait à Berlin ?
H. A. — Oui, à Berlin. J’ai dû hélas mentir à cet homme. Je n’avais pas le droit d’exposer l’organisation. Je lui ai raconté des bobards insensés et il me répétait : « C’est moi qui vous ai fait entrer ici. Je vous en ferai sortir. Ne prenez pas d’avocat ! Les Juifs n’ont plus d’argent, économisez votre argent. » Entre-temps, l’organisation m’avait procuré un avocat. Naturellement, elle l’avait choisi parmi ses membres mais je le renvoyai parce que cet homme qui m’avait arrêtée avait un visage si ouvert, si honnête. Je comptais sur lui et je pensais que c’était une bien meilleure chance que n’importe quel avocat d’emblée épouvanté.
G. G. — Vous vous en êtes sortie et vous avez pu quitter l’Allemagne ?
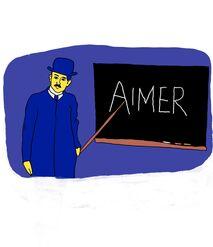
Dans son livre à paraître, Au début est la confiance, le philosophe Mark Hunyadi montre que la confiance est à l’origine de tous nos comportements…

Du billet de banque aux grands emprunts, en économie, rien n’a de valeur sans confiance. Alors que les Anciens y voyaient un acte de foi soutenu par Dieu, les Modernes ont cru avec Hobbes pouvoir la fonder sur l’État. À qui peut-on…
Si l’interdit de l’inceste n’appartient pas à la nature humaine, devons-nous prendre peur ? Non, il faut quand même avoir confiance en l’homme, soutient l’auteur de l’Encyclopédie, partisan d’une sexualité affranchie de toute hypocrisie…
Sans compter une brève ouverture estivale, cela va faire un an que les salles de sport sont fermées. Que devient le sport en temps de Covid…

Faire des droits de l’homme une expression discriminante est une erreur, pour la juriste Catherine-Amélie Chassin. Étymologiquement, « Homme…

Alors que nous sommes inondés de recommandations sur ce qu’il faut faire et penser de l’épidémie – “restez chez vous”, “allez voter”, “faites…

La danse classique est l’un des domaines où la quête de perfection est la plus impitoyable, la plus extrême. Pourtant, au-delà de sa maîtrise, la…
